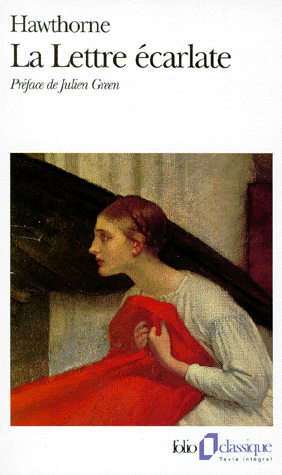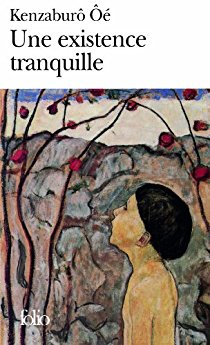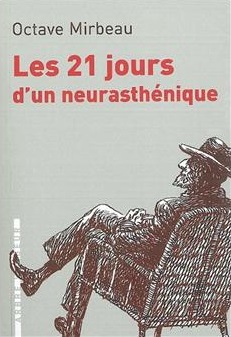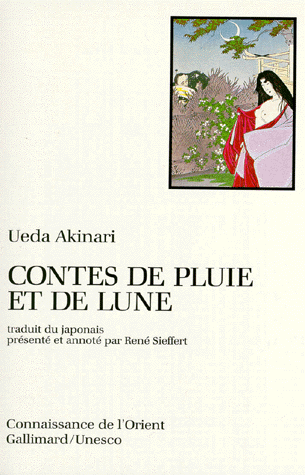Le Monde d’Hier, Stefan Zweig
Traduit de l’allemand par Serge Niémetz, Editions Belfond (Livre de poche), 506 pages
J’avais opté pour les mémoires de Schnitzler (Une jeunesse Viennoise) avant mon séjour à Vienne, j’aurais pu lire aussi Le Monde d’Hier, où Stefan Zweig décrit bien cette société des amis, dans les cafés. C’est vraiment quelque chose qui donne à rêver. Zweig donne vie, avec beaucoup d’amour, à ces portraits de gens de lettres, Rilke entre tous. Cependant tout cela tourne comme on le sait au tragique, et là Zweig s’ingénie à faire le prof d’histoire, et ― je crois que je préfères ses fictions ― le livre tendait à me tomber des mains. On sent Zweig dépassé par son sujet, ça se comprend, mais il n’est pas sans l’aborder avec une certaine grandiloquence dont il finit par faire étalage plus que de son amitié.
« En dernière analyse, je crois qu’il est dû à un défaut de ma nature : au fait que je suis un lecteur impatient et plein de fougue. Toutes les redondances, toutes les mollesses, tout ce qui est vagues, indistinct et peu clair, tout ce qui est superflu et retarde le mouvement dans un roman, dans une biographie ou une discussion d’idées m’irrite. Seul un livre qui, constamment, page après page, se maintient au niveau le plus élevé et vous entraîne tout d’un trait jusqu’à la dernière sans vous laisser le temps de respirer me donne un plaisir sans mélange. Je trouve que les neuf dixièmes des livres qui me sont tombés sous la main tirent trop en longueur par des descriptions inutiles, des dialogues prolixes et des personnages secondaires dont on pourrait se passer, et sont par là trop peu passionnants, trop peu dynamiques. »